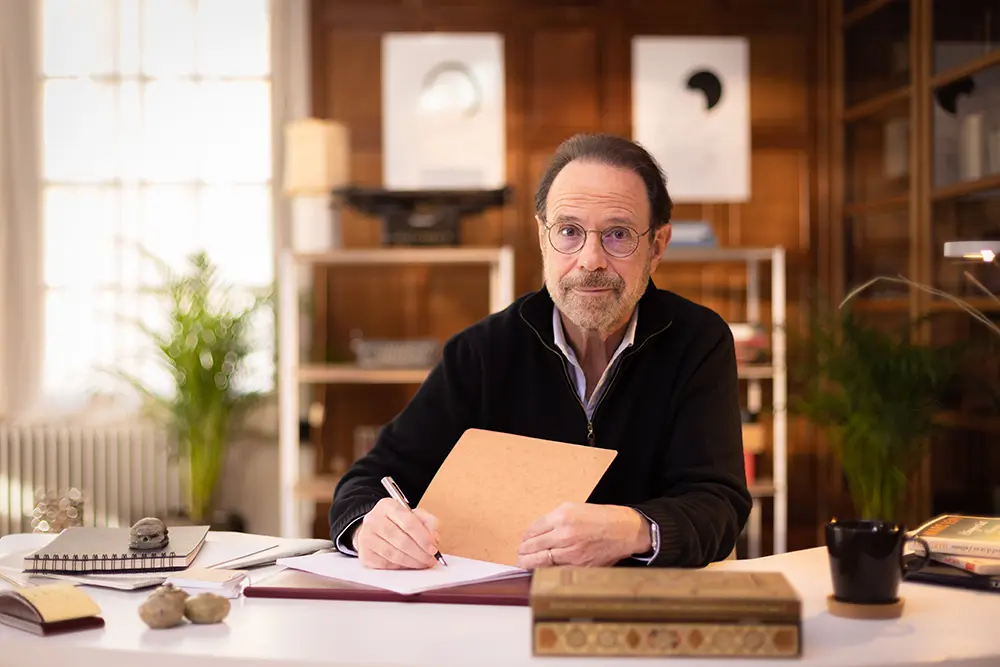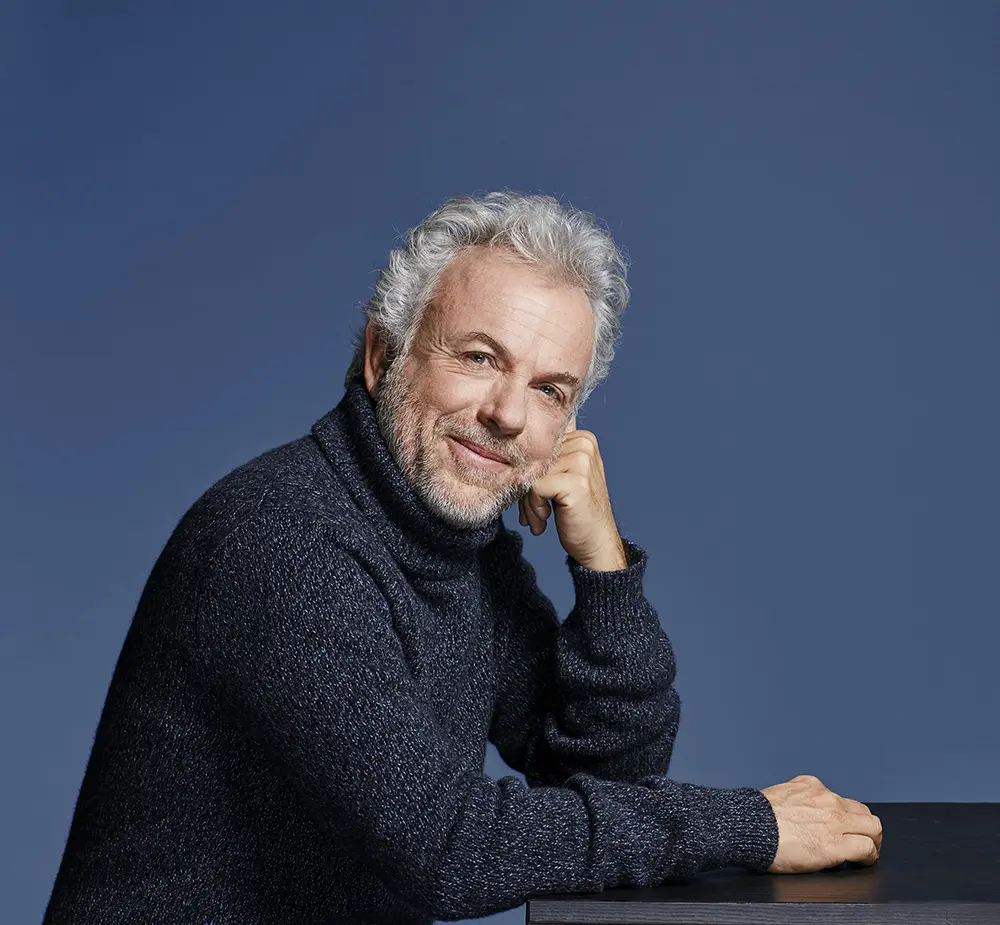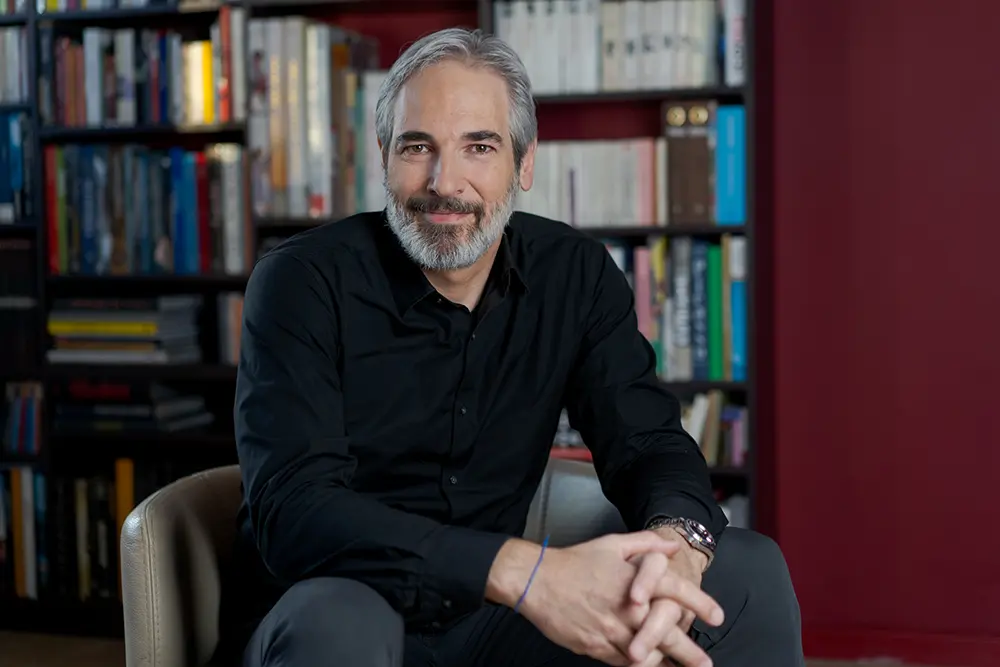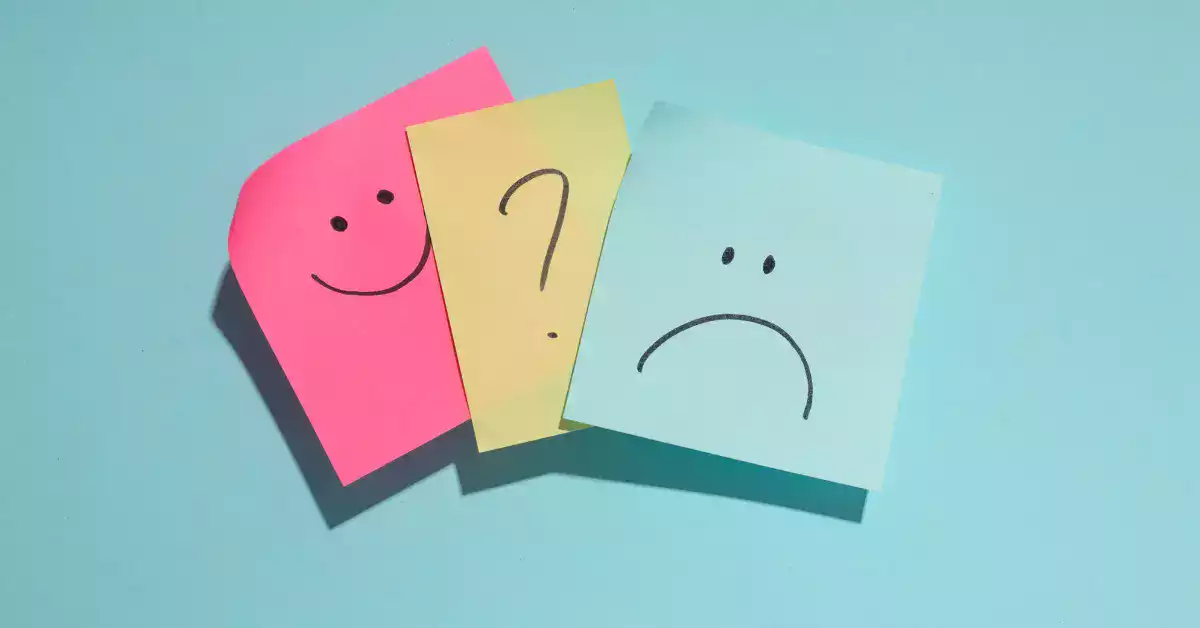Si vous avez déjà eu l’impression de ne pas pouvoir avancer dans la vie parce qu’il n’y a pas assez de succès pour tout le monde, vous avez fait l’expérience de la théorie du conflit. « La théorie du conflit est la croyance selon laquelle les personnes et les systèmes sont naturellement en conflit et en compétition les uns avec les autres pour des ressources limitées », explique le Dr Patrice Le Goy. Elle ajoute que « la théorie du conflit suggère également que les personnes qui détiennent le pouvoir feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le conserver »
Le philosophe allemand Karl Marx est considéré comme le père de cette théorie, mais d’autres l’ont développée. Nous examinerons en profondeur ce qu’est la théorie des conflits, comment l’idée s’est développée et a évolué au fil du temps, comment elle est liée à d’autres théories sociologiques et si elle est toujours pertinente pour la vie d’aujourd’hui.
CHAPITRES
ToggleIntroduction à la théorie des conflits
Même si le terme peut sembler un peu complexe, la théorie des conflits est une idée simple qui peut être utilisée pour expliquer de nombreux éléments de notre vie, tels que les classes sociales et l’inégalité des richesses. Le Goy explique que « les gens pensent souvent à cette théorie en termes de raisons pour lesquelles la guerre et d’autres conflits majeurs ont lieu, mais nous pouvons également y penser dans notre vie de tous les jours »
La théorie des conflits repose sur quelques principes : Les ressources de notre monde sont limitées, les humains agissent en fonction de leur intérêt personnel et les conflits ne peuvent être évités au sein des groupes sociaux et entre eux. Elle est considérée comme l’opposé d’une idée appelée fonctionnalisme, qui affirme que la société travaille naturellement ensemble pour le plus grand bien et que chaque individu remplit une fonction à cet égard.
Cette théorie est enseignée dans les cours de sociologie et ses principes, tels qu’ils ont été présentés par Marx, ont été élargis au fil des ans pour inclure des explications sur la guerre et l’inégalité raciale.
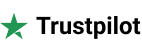


Développement historique et penseurs clés de la théorie des conflits
Introduite pour la première fois par Karl Marx, la théorie du conflit a été utilisée pour expliquer d’autres phénomènes sociaux au fil du temps. Macchiavelli et Thomas Hobbes ont présenté des théories qui ont ensuite été affinées par Marx. Ce dernier a utilisé la théorie des conflits pour expliquer comment la classe ouvrière agit en tant que productrice de biens pour la classe supérieure. Le sociologue Max Weber a ensuite complété la théorie en y ajoutant la politique, la race, le sexe et l’éducation. Selon Weber, l’inégalité aggrave les conflits et oblige les gens à être compétitifs tout en ne leur donnant pas des chances égales en raison de leur manque de mobilité.
W.E.B. DuBois a également utilisé la théorie du conflit pour expliquer le racisme à la fin des années 1800. Il a mené des recherches en personne auprès de familles noires de Philadelphie et en a parlé dans The Atlantic, en mettant l’accent sur les difficultés rencontrées par les Noirs aux États-Unis.
Dans les années 1950, le sociologue C. Wright Mills a examiné la théorie des conflits sous l’angle des grandes organisations au pouvoir. Il a suggéré qu’une classe d’élite était formée par le gouvernement, l’armée et les entreprises.
La théorie du conflit a été présentée à l’époque moderne par le candidat à la présidence Bernie Sanders. Il a déclaré que les dons de campagne que les républicains et les démocrates acceptaient de la part des banques et d’autres grandes entreprises les faisaient pencher en faveur de ces organisations et plaçaient les individus sous leur influence. Bernie Sanders s’est présenté comme un membre du peuple, par opposition à un membre de la classe supérieure qui se range du côté des entreprises.
Concepts fondamentaux de la théorie du conflit
La théorie des conflits s’articule autour de quelques concepts de base.
La concurrence
L’idée que nous sommes tous en concurrence est au cœur de la théorie des conflits. Selon Le Goy, cela se traduit par des situations telles que « des personnes en concurrence pour un nombre limité d’emplois bien rémunérés et assortis de bons avantages, ou pour une offre limitée de logements abordables dans une zone recherchée »
Dans cette compétition, celui qui remplit le mieux une fonction n’est pas inné à réussir. Elle note que « ces questions découlent du fait qu’il n’y a pas assez de ces produits de première nécessité pour satisfaire tout le monde dans la société et nous savons que les décisions concernant les bénéficiaires ne sont pas toujours fondées sur les besoins ou le mérite »
Le pouvoir
La théorie du conflit implique un groupe au pouvoir qui a le désir d’y rester. La richesse et le pouvoir sont liés, les riches étant généralement considérés comme les responsables. Cela a du sens pour les gouvernements, les entreprises et les individus qui détiennent une quantité disproportionnée de richesses par rapport au reste de la population.
La théorie du conflit implique l’idée que la classe supérieure utilise les biens et les services fournis par la classe ouvrière et que cette dernière doit rester dans sa propre stratosphère sociale afin de maintenir le système en place. Cette théorie va à l’encontre de l’idée de mobilité ascendante.
Manque de ressources
L’idée que les ressources sont limitées explique pourquoi nous devons nous disputer le pouvoir. Les ressources limitées sont la clé de la théorie des conflits. Cela peut sembler stupide parce que le monde est si grand, mais si vous réfléchissez à la façon dont nous nous concentrons dans ce monde, cela prend tout son sens. Nous vivons dans des villes densément peuplées et, dans les plus denses d’entre elles, vous pouvez être confronté à une concurrence intense rien que pour trouver un nouveau logement ou une nouvelle école pour votre enfant.
Marginalisation
La théorie du conflit implique que certaines personnes sont marginalisées en raison d’un déséquilibre des pouvoirs. Le Goy explique que « la théorie du conflit est présente dans la société d’aujourd’hui lorsque les droits des groupes marginalisés sont bafoués. Dans ce cas, on constate que le pouvoir est détenu de manière très étroite et que, dans certaines situations, les gens ne peuvent pas jouir de leurs droits fondamentaux » Lorsque certaines personnes détiennent plus de pouvoir que d’autres, celles qui n’en ont pas sont vouées à être marginalisées.
La théorie du conflit par rapport aux autres théories sociologiques
Si le fonctionnalisme explique également pourquoi la société est telle qu’elle est, il le fait à l’inverse de la théorie du conflit. Il se concentre plutôt sur la façon dont nous voulons tous travailler pour le bien commun. La théorie du consensus explique également pourquoi la société fonctionne comme elle le fait, mais elle affirme que notre ordre social est basé sur nos valeurs et nos normes. Une autre théorie sociologique est l’interactionnisme symbolique, qui se concentre davantage sur les individus et sur la manière dont ils agissent en fonction des significations qu’ils donnent aux différents éléments de la vie.
La théorie du conflit diffère de la plupart des autres théories sociologiques en ce qu’elle est centrée sur le conflit. En tant que telle, elle est considérée comme une approche de l’humanité plus proche du « verre à moitié vide » que du « verre à moitié plein ».
Applications de la théorie des conflits
La théorie du conflit peut être appliquée à de nombreuses facettes de la vie dans notre société.
En politique
La théorie du conflit s’applique à la politique, car les dirigeants de notre pays sont souvent issus de la classe supérieure et de milieux aisés. Les responsables établissent des règles et des lois pour ceux qui ont moins d’argent et ont le pouvoir d’abaisser la qualité de vie des masses.
Lorsque le gouvernement décide de faire la guerre, cela peut également être un exemple de la théorie des conflits : Un groupe en charge choisit où vont nos ressources nationales et comment elles sont utilisées, tout en demandant aux personnes issues de milieux économiquement défavorisés de mener les combats.
Dans le domaine de l’éducation
Les théoriciens du conflit considèrent que notre système éducatif maintient les gens dans leur classe économique sans permettre la mobilité. Cela se traduit par le fait que les écoles des quartiers défavorisés disposent de budgets et de ressources moindres et que les personnes aisées envoient leurs enfants dans des écoles privées coûteuses où ils peuvent bénéficier d’une éducation de meilleure qualité. Les écoles des quartiers économiquement favorisés affichent généralement des taux d’obtention de diplômes plus élevés et un plus grand nombre d’étudiants qui poursuivent leurs études dans un établissement d’enseignement supérieur de quatre ans que les écoles des quartiers à faibles revenus.
En économie
L’économie est un élément majeur de la théorie des conflits, car l’idée sous-jacente est que la classe ouvrière est coincée dans sa position, créant des biens et fournissant des services, tandis que les riches feront tout ce qu’ils doivent faire pour rester au pouvoir. Cela crée des inégalités et une marginalisation, et sans mobilité ascendante, ces problèmes perdureront au fil du temps.
Le Goy note que « cette idée nous aide à mieux comprendre les raisons pour lesquelles les gens peuvent se comporter d’une manière qui semble égocentrique et indifférente à la société dans son ensemble. Alors qu’en fait, ils essaient simplement de s’accrocher à ce qu’ils perçoivent comme leurs besoins fondamentaux »
Critiques et limites de la théorie du conflit
Comme toute théorie, la théorie du conflit a ses limites et ses critiques. Certaines personnes n’y croient pas du tout, tandis que d’autres considèrent que certaines de ses notions sont vraies, mais n’apprécient pas la manière dont elle encadre l’humanité. « L’une des principales limites de la théorie des conflits est qu’elle suppose un comportement humain égoïste inné, sans tenir compte des circonstances qui peuvent conduire à ce comportement (concurrence pour des ressources très limitées) », explique M. Le Goy.
La théorie du conflit n’a pas non plus fait l’objet de recherches suffisantes. Il n’y a pas d’études spécifiques qui montrent que les êtres humains sont intrinsèquement compétitifs ou que toutes les personnes riches tiennent à le rester. Elle voit les gens sous un jour négatif et ne tient pas compte des très nombreuses personnes qui n’axent pas leur vie sur la compétition et le pouvoir.
Enfin, la théorie du conflit peut être considérée comme une simplification excessive des luttes sociales. Elle ne tient pas compte du fait que des luttes de pouvoir se produisent toujours au sein des classes, et elle n’accorde aucune crédibilité aux moyens mis en œuvre par les individus pour résoudre les conflits et favoriser la mobilité.
La pertinence de la théorie des conflits aujourd’hui
La théorie du conflit est pertinente pour la vie d’aujourd’hui si vous cherchez une explication aux problèmes qui existent dans la société. Cela dit, en tant que théorie sociologique, elle présente l’humanité sous un angle négatif et n’est pas particulièrement populaire auprès de la plupart des gens à l’époque moderne. Elle peut être utile pour expliquer certains comportements, mais elle ne peut pas servir d’excuse à ces comportements. C’est une idée intéressante, et en en apprenant davantage à son sujet, nous pouvons mieux comprendre comment les gens, au fil des ans, ont perçu les luttes de notre société.